I
Je passe chez moi ce stigmate confessionnel d’avoir un goût immodéré du spectacle immoral. Peut-être y a-t-il à voir, là, le théâtre lointain d’une méditation au maintien du squelette de ma personne ?
C’est ainsi, ma haine n’a jamais manqué de manières à montrer combien je l’aime. Â ! Poussières ! Que j’aime vos mépris ! Jusqu’aux songes de Baudelaire qui haïssent le tragique et toute chose trop grande !
L’amour, excité par une factice réputation, attise ce besoin impérieux de décerner les coups de fouet, parce qu’en effet ils procurent le courage de l’amour en décomposition, dans une société en décomposition, unanime et morbide.
Sa réputation mondiale, ses gloires littéraires ne sont que les fables qui cachent sa propre dissolution morale centuplée d’importance par une dissolution sociale annoncée pour les lendemains immédiats (Notez que je ne critique pas mais je constate, qu’en fin de compte, demain sera toujours un doute). L’amour, conservé dans l’unité et la majesté de sa puissance, fut considéré comme un chef-d’œuvre qui ne servit qu’à élever une foule entière au sage esclavage envers la conception unique de la destinée des hommes et, au-delà, du monde.
II
Voyez-vous, ma haine m’a conduit tel un principe farouche à découvrir le sens monumental de la religion qui a trop longtemps masqué le besoin d’absolu. L’amour du monde, mieux, les religions du monde ne pouvaient atteindre cet absolu car elles ne manifestaient qu’un retour victorieux de la cruauté sous des rires triomphaux.
Aussi loin que les peuples se réunirent par le sexe, au travers de cette puissance rythmique collective, avec ses danses sacrées, les hommes ont psalmodié son rire ou ses larmes, ont mimé sa tragédie ou son orgie, ont chanté de leur esprit sensuel ce rêve à propos de la messe comme un jeu érotique et bestial.
Y patauge le génie servilement attaché à flatter les exercices acrobatiques au cours de charmantes relations aussi stupides qu’un tableau, une sonate, un poème qu’il impose au public par la force propre à sa création.
III
Or, l’art étant perdu à essayer d’accaparer l’art, ou du moins, je le soupçonnais déjà il y a vingt ans, le spectacle essayant d’accaparer l’homme par de puissantes réclames, je ne devais être, parfaitement à cette époque, qu’un pauvre diable aveugle, à sauter sur un pied comme une petite fille et à battre des mains comme une otarie devant autant de supercheries gravées sur les frontons des temples de la république : architecture, art, religion, poésie et autres effigies de l’amour universel.
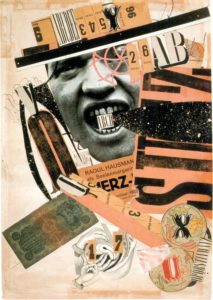
Le besoin, ce caca de l’homme est plus fort que son ânerie cagneuse, heureusement. Nautonier partant en chasse de l’amour ingénu, des bénédictions de mauvais riche et des atermoiements sur les orphelines, je réalise enfin que ma haine fécondée par la vidange quotidienne de mes intestins évacue à ce rythme toutes les sottises infâmes que le spectacle prétend attirer du public telle que la fraîcheur de la jeunesse, la santé par le travail ou bien encore les bienfaits de la liberté. Aujourd’hui, je peux déclarer haut et fort : vive l’amertume et vive la mort !
Il en est des mouvements littéraires et politiques autant que de leurs apparences : ceux qui tiennent la caisse jouent le rôle d’intermédiaires entre les acteurs théoriciens et les spectateurs théoricisés – savant mélange d’endoctrinement et d’envoûtement – la théorie servant d’écran matériel ou d’interface virtuelle entre les instrumentistes de la théorie et les moutons qui n’ouvrent jamais la bouche ou presque en quête d’explications ou de pâturages, pourvu que l’herbe soit verte au Paradis.
Seulement, la parole déroule la rumeur du vent ! Une pantomime qui confère déjà aux impulsifs ce droit à posséder des sentiments et des passions comme objets essentiels. L’amour, dit-on, est en accord constant, cet équilibre qui élève l’âme et, à l’inverse, tout s’écroulerait. Cette vraisemblance, ne nous méprenons pas, si vous le voulez bien, tiré au canon académique ou grâce à l’héroïsme du saint doux, veut par tous les moyens prendre le pouvoir sur l’homme, par tous les procédés artistiques, gymnastiques et, en dernier ressort, militaires. Pourtant, l’interpénétration, le croisement et l’association de l’amour et de la mort me donnèrent progressivement des émotions inattendues, nombreuses commotions, multiples éclairs.
Progressivement, je découvrais avec un émerveillement croissant le martyr, le déshonneur, la lubricité, l’assassinat et la prostitution. Un nouveau système de valeurs s’échelonnait sous la surface et dans des profondeurs, pour moi, autrefois inconnues. J’assistais à une descente monumentale dans l’océan de mes souvenirs, redécouvrant le cycle des marées propre aux songes, m’instruisant à bord d’une marie-salope. J’étais conduit par la fureur et les caprices des éléments prodigieusement enchevêtrés. Des espaces nouveaux s’ouvrirent lentement de cet invisible et splendide abîme : les embryons microscopiques virevoltent avec les ténèbres sous-marines ; les étoiles en fusion se révèlent ces matrices générant l’enfer avec l’amour, la haine n’étant que la flamme de cet état de fait au fond des étangs où gît de nos âmes la lie.
IV
Il me semble par conséquent, quelque forme d’expression qui puisse impressionner notre sensibilité et agir sur notre intelligence, que l’art soit une conception en décomposition, la création transcription d’une mise en scène de l’Œuvre et transfiguration d’un génie admirable, certes, mais inaccessible.
Je me suis laissé dire que le sacrifice signifiait cette critique de soi, car autrement l’homme serait inférieur à sa tâche. Cela signifie-t-il seulement que l’homme n’eût aucune valeur, ni qualité qui existât en lui, d’une génération à l’autre ? Car il y a, ne vous en déplaise, pas de hasard. Le sacrifice, ce crime parmi les crimes, répond parfaitement à une idylle sublime prouvant par l’exemple, combien la mélancolie de l’existence peut décroître en alimentant une flamme dont l’énergie serait l’essence même de la vie, cette mystérieuse conquête sur notre clairvoyance, comme l’éternité s’impose sur le néant, et qu’un gnome appelé Dieu ne porte pas même dans son cœur.
N’est-il pas vrai ou, tout au moins, plus authentique, que l’école, en laquelle se représente la morale, ne soit pas sans rapport aucune avec cette action essentielle ? Arrêtons en effet, d’être résolument idéaliste. Le sacrifice représente quelque chose comme la lutte entre des formes bâtardes ou dégénérées de la vie, paraissant vouées de la sorte, inexorablement à la misère, tandis que la mort, cet art nouveau, emplit de perspectives immenses, promet un grand avenir et imagine, au travers de la décomposition primitive et en même temps barbare, ce qui fait la force de la vie en fusion. De plus en plus le mouvement précipite la durée entraînant l’espace et avec lui, l’équilibre. Ce mouvement de mort manifeste aux hommes, par les circonstances de leur vie, la mécanique qui tend à précipiter les mouvements qui, se passant de science et de tradition, d’art et de religion, lui explique à quel point innée est son origine et surtout quand elle peut se passer d’organe pour exister.
La vie a été engendrée et non la mort. Un homme déjà qui chante devient cet édifice qui cherche l’illusion de croire à son vouloir. De là les poèmes qui traversent des éléphants au cœur de l’écume ou dans la fumée d’une agonie sont des moments inattendus et aussi, des nouveau-nés en d’obscurs instincts, bien incapables de nous montrer le sens humain d’un ciel d’orage ou l’essence cosmogonique de l’existence. L’amour même pour l’espace ne suffit point en sorte que naquît tout à fait la vie, l’inclination au temps n’empêche en rien la perte de la mémoire, du génie des lumières et de la sagesse des sages. L’histoire s’estompe avec les ruines, ce qui est propre à la faire paraître anachronique. Hommes ! Gesticulez ! Soit ! Mais que vos gestes soient justes. Car la comédie humaine représente votre réel génie de maintenir, aux côtés de la mort, la genèse de votre futur.
En tout cas, – dites-vous, hélas !, – la vie n’est rien d’autre qu’un prétexte, une trame, un squelette du serpent nommé durée, un drame qui circule dans l’espace, un drame moral et psychologique pour révéler ce qui ne peut être, présentement sous vos yeux et en votre entendement, dévoilé.
V
Oserai-je rêver de la disparition du temps ? Que mille ans jaillissent sous le galop d’un cheval, dans la fumée d’une cigarette à moins de les voir se condenser dans l’éther ? Nous aurions sous les yeux Jésus en croix et vingt siècles de lumière expédiés dans un projectile. Le temps, ce cliché inerte de l’émotion, n’est devenu nécessaire qu’afin de cultiver les souvenirs enfermés vivants dans l’espace même de notre cerveau.
J’attends la fin du spectacle, de la philosophie, de la religion et de toutes les grandes choses autour desquelles la multitude s’assemble. Le pessimisme du prophète sort de l’imagination d’un être qui a le privilège d’annexer l’éternité, écœuré des fictions sentimentales. Le prophète reconnaît sa vertu personnelle. Destinant aux masses un ensemble d’actions dont l’expression principale, toute de déconstruction en apparence – d’ailleurs difficile à définir – possède la particularité de ramener les navires au port.
Février/Juillet 2005
